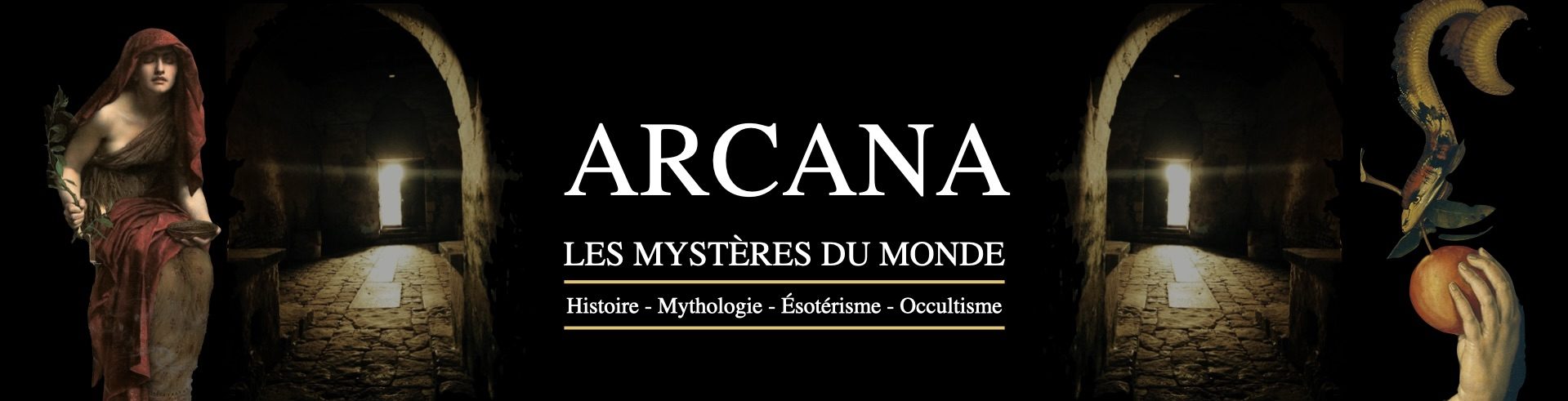La légende du Golem appartient aux croyances des traditions hébraïques. Il s’agit d’une créature créée artificiellement via la science kabbalistique, la superstition se retrouve dans certains textes de la Mishna et du Talmud, cependant c’est réellement à partir du Moyen Âge, avec la création de la kabbale, que la légende du golem se démocratise.
Le golem est un être sans conscience, sans libre arbitre et dévolu à la seule volonté de son créateur. La religion juive interdit toute pratique des sciences occultes, mais cela ne va pas empêcher les kabbalistes de se lancer dans l’entreprise.
La légende du Golem de Prague est sans nul doute la plus célèbre des légendes concernant le mythe du monstre d’argile. Il devient un protecteur ou du moins la croyance en son existence fait office de réconfort spirituel face aux difficultés de vie dans le ghetto de Prague.
Nous allons présenter les origines du mythe, la légende du Golem de Prague, les influences de ce mythe dans les œuvres modernes et notamment le célèbre Frankenstein de Mary Shelley, puis nous terminerons avec la symbolique de ce mythe ésotérique.
- ▶Soutenir la web TV sur Tipeee, accès aux accademia « voir conditions sur Tipeee » : https://www.tipeee.com/arcana-mysteres-du-monde
- ▶Liste des Accademia : https://arcanatv.fr/liste-des-accademia
📚Commander mon livre : https://www.amazon.fr/Arcana-mystères-monde-Ludovic-Richer/dp/2380150044
🧑🎓 Rejoignez la chaîne pour bénéficier d’avantages lors des lives :
https://www.youtube.com/channel/UCNpjt1HR25fpXmb-H28yajQ/join
🔔 Cliquez sur la cloche pour suivre toutes mes vidéos !
- Facebook : http://facebook.com/mytharcanum
- Twitter : https://twitter.com/ArcanaMdM
- Instagram : https://www.instagram.com/arcana_mdm
- Salon discord : https://discord.gg/Q98R3QA
- Faire un Don via Paypal : https://www.paypal.me/arcanamdm
Bibliographie :
- La bible et le Talmund
- Sefer Yetsirah
- Florian Balduc, De Faust au Golem : Histoire et mensonges derrière la légende
- Le Golem De Prague, les récits juifs du ghetto
- Le livre des superstitions, Eloise Mozzani
- Dictionnaire historique de la magie et des sciences occultes
- La magie et la sorcellerie Védrine et Jean Jordy